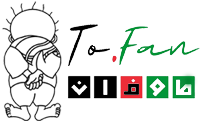Bouamama et Collon : La Palestine, clé du monde et du récit
Par Nacer Kandil
Deux perspectives intellectuelles majeures émergent dans les milieux culturels et médiatiques européens, s’efforçant de démêler les racines du conflit devenu le terme le plus recherché au monde : Palestine.
Ces perspectives émanent du sociologue et écrivain franco-algérien Saïd Bouamama et du journaliste belge de renom Michel Collon. Affinités intellectuelles et personnelles, les deux hommes ont contribué de concert à de nombreuses sessions de recherche enregistrées sur le conflit palestinien, faisant preuve d’une remarquable harmonie malgré leurs points de départ et leurs approches différentes.
Saïd Bouamama, issu d’une sociologie critique, perçoit le conflit comme le prolongement d’une structure coloniale qui perdure depuis le XIXe siècle, ayant simplement adapté ses outils et évolué d’une occupation militaire directe vers de nouvelles formes de contrôle économique, sécuritaire et culturel. Michel Collon, critique virulent des médias occidentaux, analyse les mécanismes du « récit» qui précède toute guerre. Il estime que la compréhension du conflit commence par le décryptage des secrets du «consentement populaire» produit par la machine de propagande de Washington, Bruxelles et Tel-Aviv.
Bouamama et Collon s’accordent à dire qu’Israël n’est pas un «fait historique d’exception», mais bien un projet colonial méticuleusement orchestré, conçu pour servir de tête de pont à l’Occident dans la région.
Dans son dernier ouvrage, « Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient », Bouamama place Israël au cœur de l’« architecture impériale » conçue par la Grande-Bretagne et héritée par les États-Unis. Cette architecture repose sur trois piliers : empêcher toute unité arabe ou régionale, contrôler les ressources pétrolières et gazières et les routes maritimes, et ériger une barrière géopolitique garantissant la dépendance continue du Moyen-Orient vis-à-vis de l’Occident. Collon, quant à lui, perçoit Israël comme un produit de propagande sophistiqué, non pas comme une simple armée ou une entité géographique, mais comme un véritable « système narratif ». C’est l’État qui a su se présenter au monde comme : la seule démocratie de la région, l’éternelle victime de l’hostilité environnante et l’allié moral de l’Occident. Selon Collon, tout cela repose sur cinq mensonges fondamentaux, répétés dans chaque guerre : la diabolisation de l’ennemi, la prétention à une guerre humanitaire, la réduction du conflit à une opposition binaire entre le bien et le mal, la manipulation des témoignages et des images, et la légitimation des comportements agressifs. Cette machine de propagande, à ses yeux, n’est pas moins importante que les avions de chasse F-16 ou le Dôme de fer, car elle fournit la justification morale nécessaire à la poursuite du projet sioniste.
Bouamama et Collon s’accordent à dire que le conflit israélo-palestinien n’est pas un conflit local, mais un tournant mondial au cœur de transformations géopolitiques majeures, de la Guerre froide à la montée en puissance de la Chine et de la Russie et au monde multipolaire. Ils s’accordent également à dire qu’Israël est un projet colonial occidental avant d’être un État-nation juif.
Ce projet ne survit que par sa fonction régionale, et non par ses frontières ou sa population. La bataille pour la conscience est indissociable de la lutte militaire et politique, car l’occupation moderne repose autant sur le contrôle du récit que sur le contrôle du territoire.
Bouamama propose une vision pour la résolution du conflit. Il ne se contente pas d’en diagnostiquer les causes ni de dénoncer la structure coloniale, mais va plus loin, visant à élaborer une feuille de route stratégique pour les Palestiniens et les Arabes, articulée autour de huit axes clés : transformer le conflit en une lutte mondiale contre le colonialisme ; unifier les champs d’action de la lutte palestinienne au sein d’un cadre unique ; et construire un axe de résistance régional solide. Il s’agit notamment de mener une guerre d’usure prolongée pour paralyser l’économie israélienne ; de démanteler la relation structurelle entre Israël et l’Occident ; d’exploiter les faiblesses structurelles de la société sioniste ; de mener une guerre de récits à travers les médias et plateformes internationaux ; et de formuler une vision politique et économique pour la Palestine post-libération.
Bouamama estime que cette vision stratégique repose sur une analyse historique, économique et géopolitique des rapports de force. Il ne s’agit pas ici d’un « règlement », mais d’une transformation radicale du système international qui ferait de la libération de la Palestine une conséquence naturelle de l’effondrement des piliers de l’hégémonie occidentale.
À l’inverse, l’analyse de Collon explique comment l’Occident a réussi à imposer son récit pendant un siècle. Collon dresse un tableau de la bataille médiatique qui révèle : la production d’images et de vidéos avant chaque guerre ; le recours à l’« information humanitaire » pour justifier une intervention militaire ; le rôle des multinationales dans le contrôle de la couverture médiatique ; les mécanismes d’achat d’influence au sein des médias ; et la manière dont les mythes sionistes ont été propagés de 1917 à nos jours. Selon lui, la récente mise à nu des médias occidentaux, suite à leur manquement à l’éthique dans la couverture de la guerre de Gaza, offre une opportunité stratégique à la résistance, car la « bataille des récits » commence, pour la première fois depuis des décennies, à pencher en faveur du récit palestinien.
Entre l’analyse sociologique de Bouamama et l’analyse médiatique de Collon, se dessinent les contours d’un nouveau moment historique: l’hégémonie occidentale décline non seulement militairement, mais aussi moralement, culturellement et médiatiquement. Israël perd sa capacité à gérer l’image d’une «démocratie victime », et la révélation de ses crimes quotidiens démantèle le récit sur lequel il s’est longtemps appuyé. L’essor des médias alternatifs remodèle la conscience mondiale, plateforme après plateforme, faisant basculer le sentiment international de la sympathie envers Israël vers le scepticisme. Parallèlement, la résistance palestinienne s’intègre à un mouvement mondial plus vaste, comparable dans son essence au mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. Ce changement d’opinion internationale, que Collon observe avec précision, ouvre la voie à la mise en œuvre d’éléments du plan stratégique proposé par Bouamama.
Ces deux approches démontrent que le conflit palestinien n’est plus un conflit de frontières ou d’accords, mais bien un conflit portant sur la configuration du nouvel ordre international. La région restera soit soumise à la logique de l’hégémonie américano-européenne, soit entrera dans une nouvelle phase de formation liée à l’évolution des rapports de force en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Face à cette transformation, la Palestine n’est plus un simple dossier, mais un enjeu central du mouvement de repositionnement mondial. Bouamama place la Palestine au cœur de la politique internationale, tandis que Collon la place au cœur du combat moral et humanitaire. Tous deux s’accordent sur un point : la période actuelle est la plus critique depuis 1948 et le potentiel de transformation est plus important que jamais, pourvu qu’une vision stratégique arabo-palestinienne unifiée émerge.
المقال بالعربية:
بوعمامة و كولون: فلسطين مفتاح العالم والروايةتتقدّم إلى الواجهة الثقافية والإعلامية الأوروبية – موقع طوفان
https://to-fan.com/archives/39140